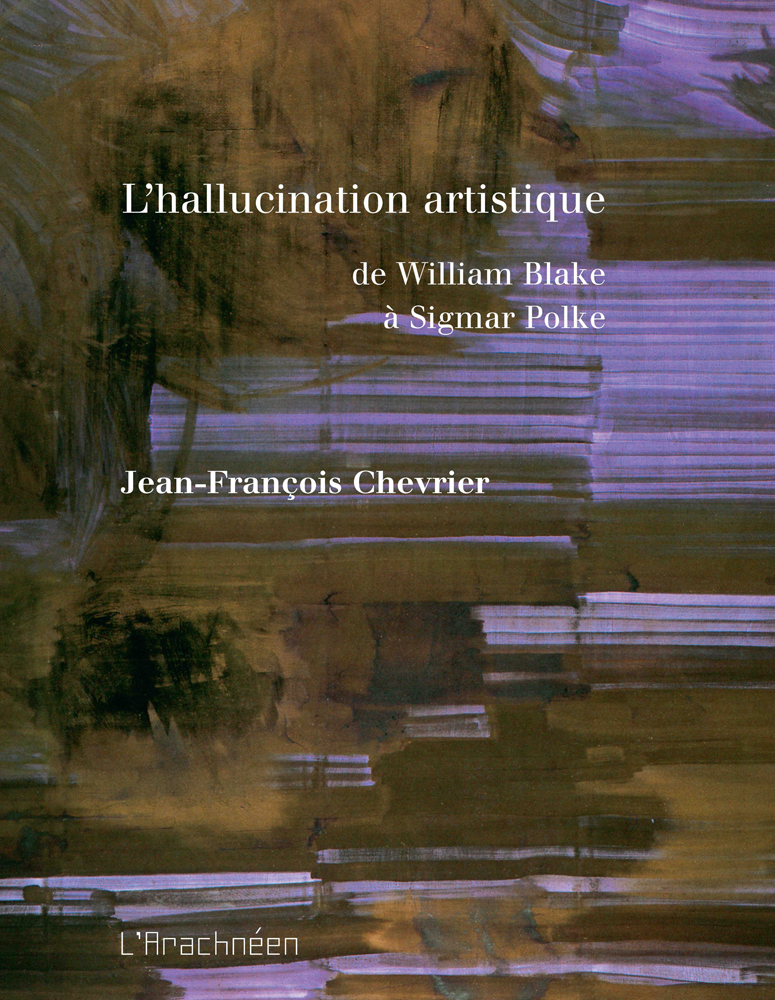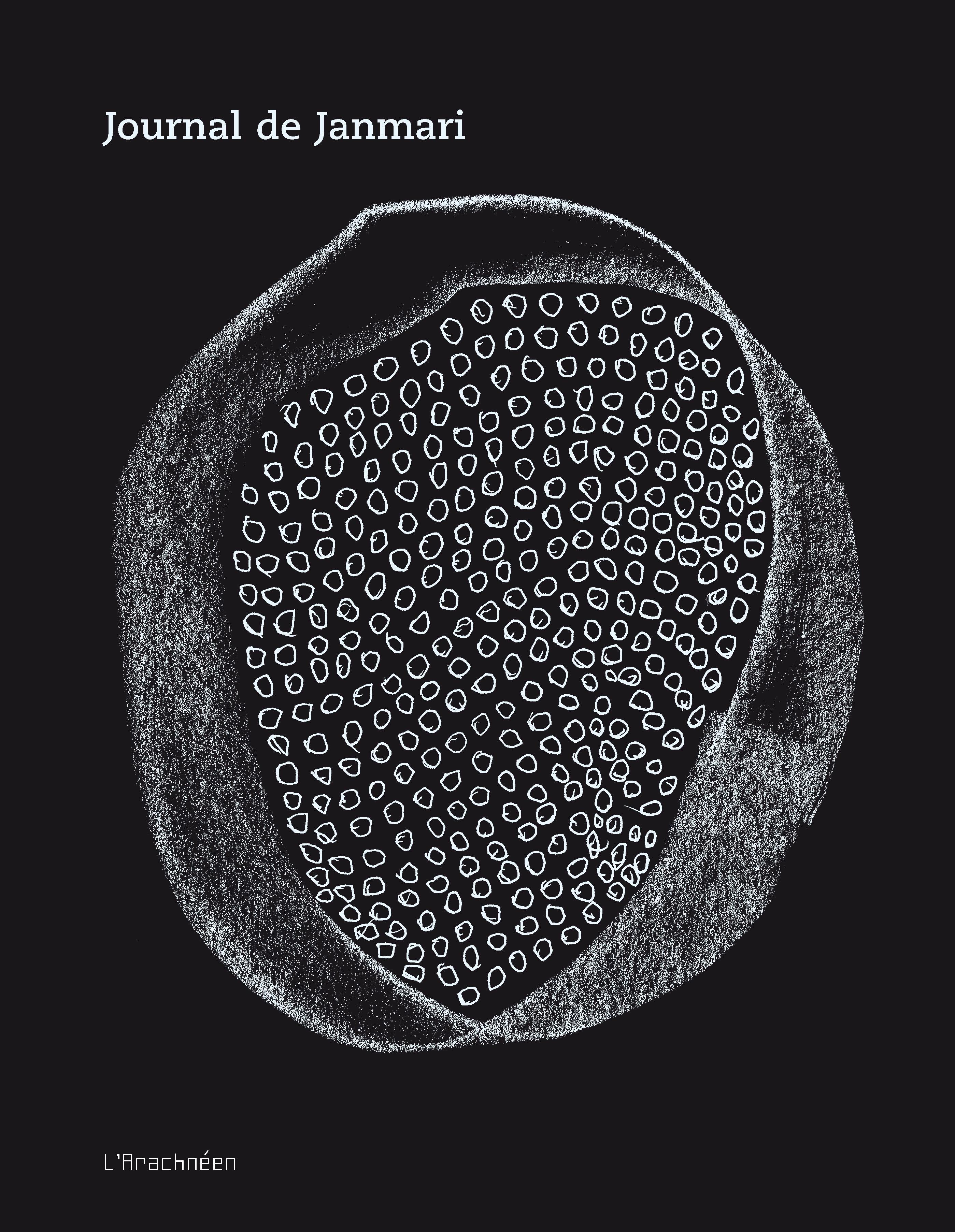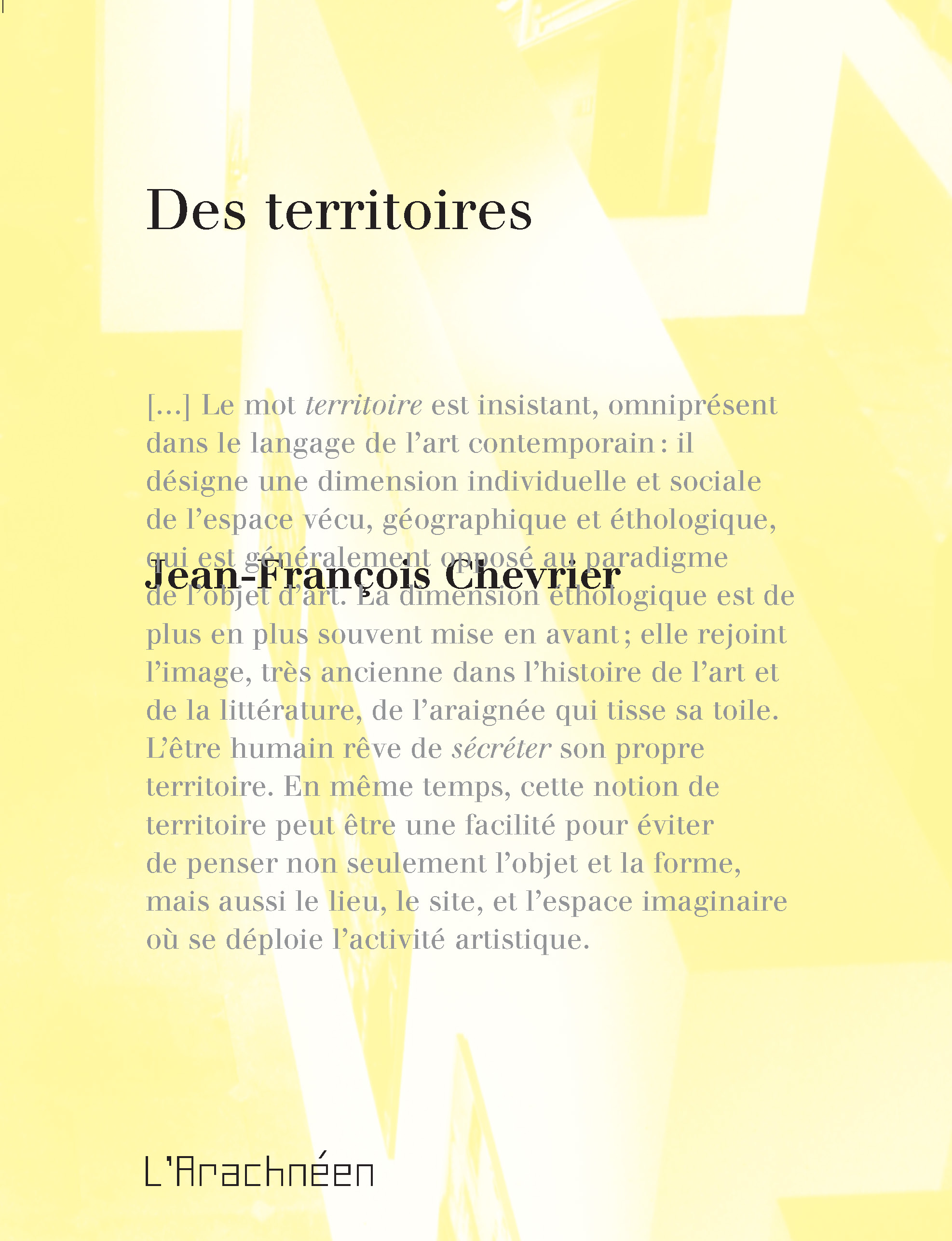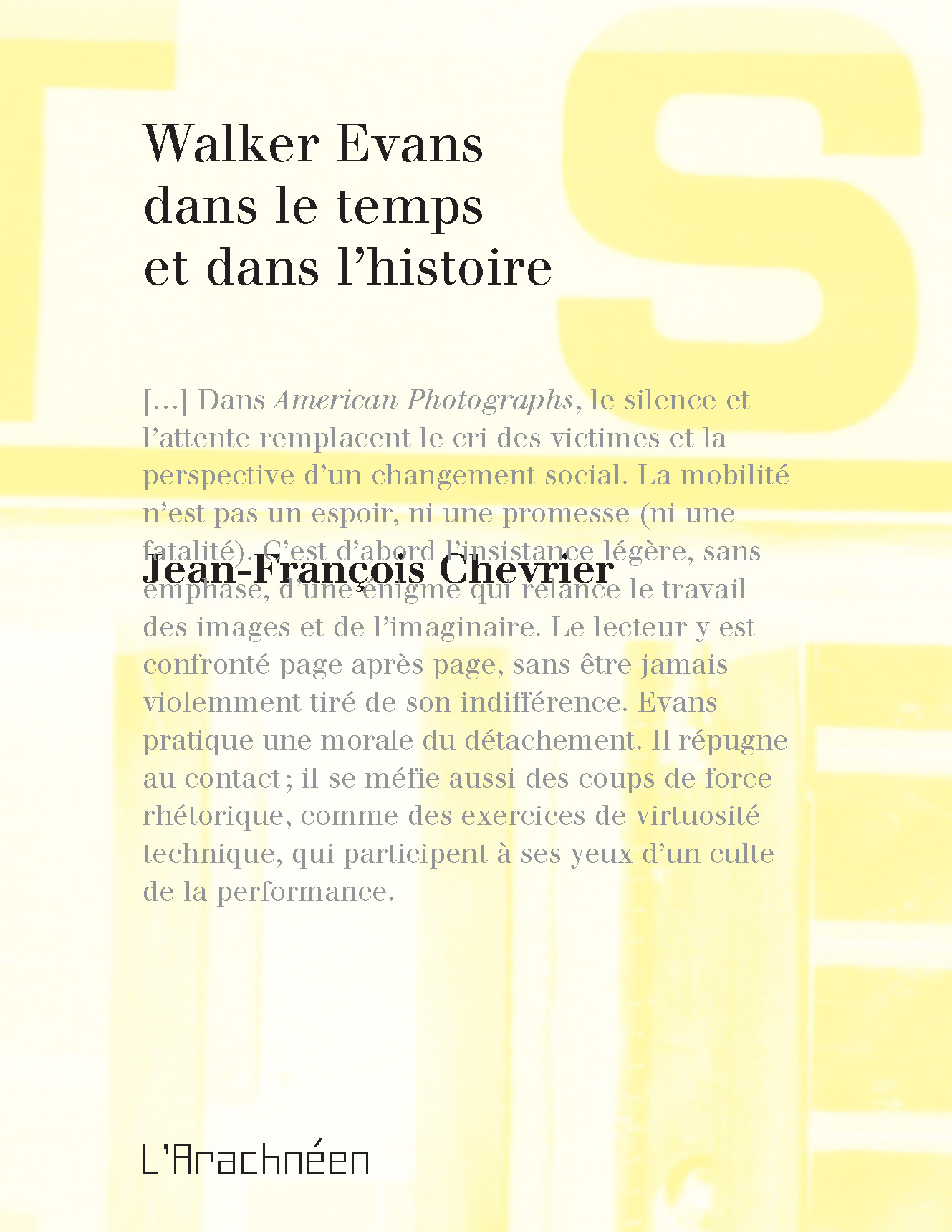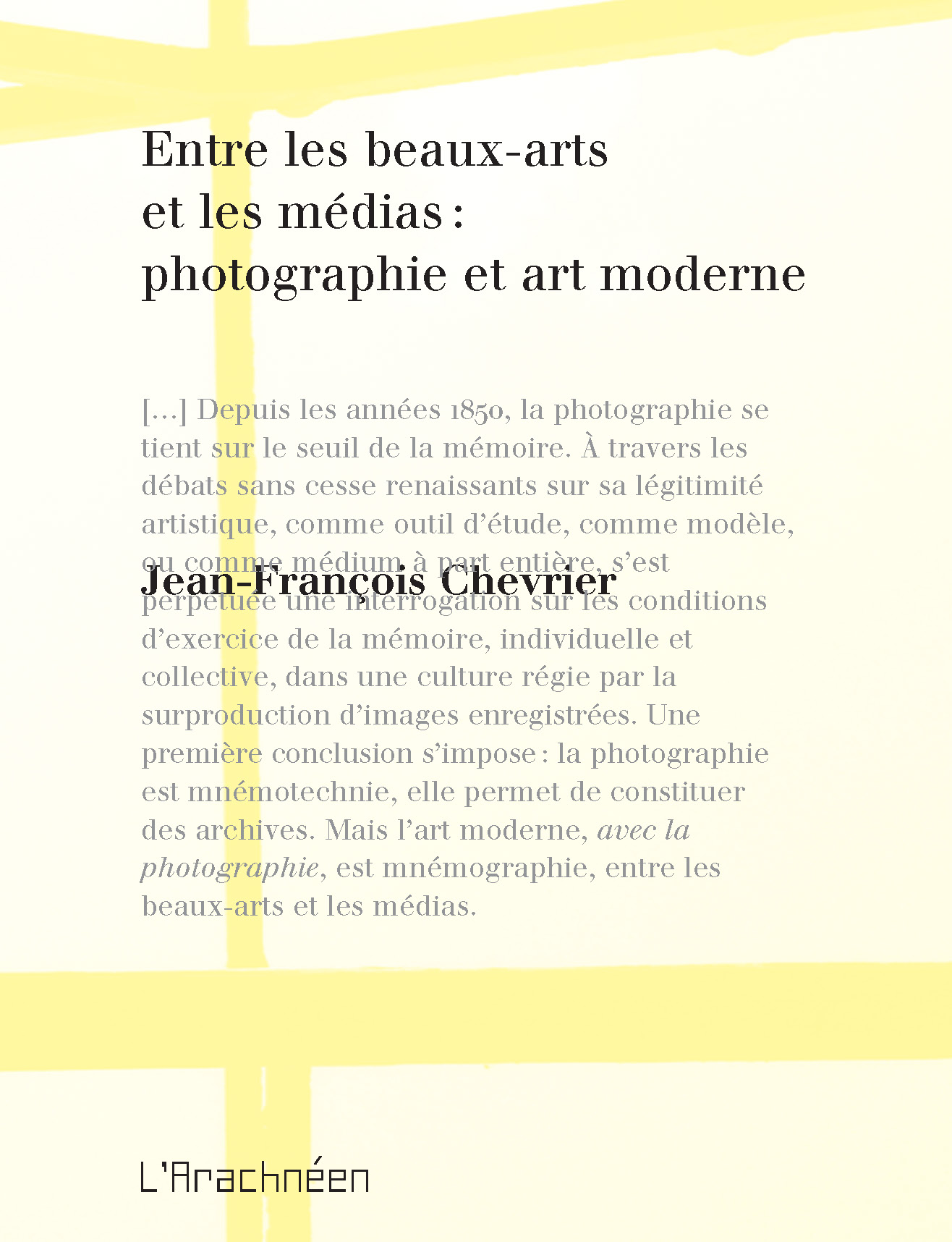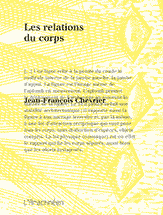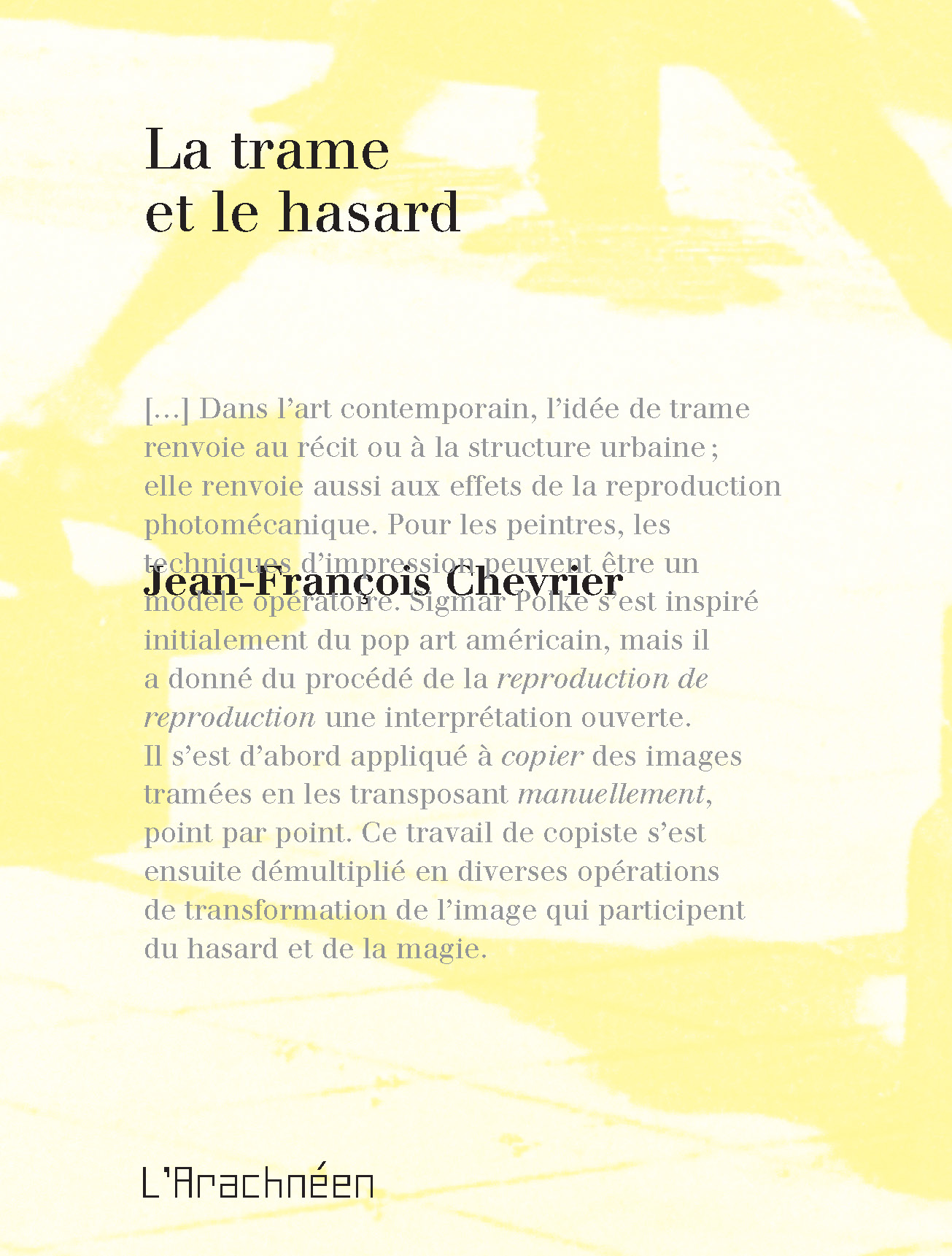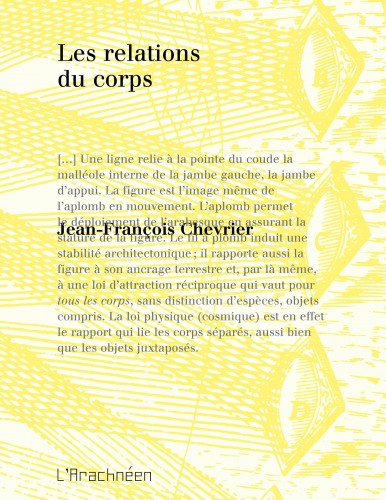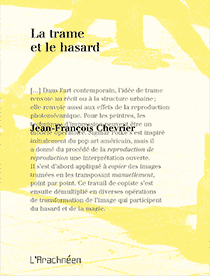Introduction
L’inactualité de Fernand Deligny
Sandra Alvarez de Toledo
« J’aimais l’asile. Prenez le mot comme vous voulez : je l’aimais, comme il est fort probable que beaucoup de gens aiment quelqu’un, décident de faire leur vie avec. Il s’agissait bien d’une présence vaste, innombrable, mais dont l’unité était évidente. » Deligny avait vingt ans – il est né en 1913 – quand il se rendit pour la première fois à l’asile d’Armentières, entre Lille et Bergues, sa ville natale. L’asile devint son île, le lieu d’une seconde naissance et d’un exil intérieur définitif, la condition de l’écriture, le modèle institutionnel et spatial de ses futures tentatives. Au début des années 1980, en plein débat sur la sectorisation et la fermeture des hôpitaux psychiatriques, il écrit un « Éloge de l’asile ». Il n’apporte pas sa voix à la contestation du « grand renfermement ». L’enjeu du redécoupage des pouvoirs entre administration, psychiatrie et justice, sur fond de remise en cause de la loi de 1838, ne le concerne pas. Que l’aliéné conserve ou non ses droits ne l’intéresse pas. C’est au contraire son irresponsabilité profonde qui l’intéresse, son incapacité à faire valoir ces droits, le flottement qui s’instaure sur son statut de personne. La vie de Deligny, son œuvre, son engagement même, s’enlèvent sur ce fond de refus de rien posséder en propre, à commencer par soi-même. Sa vision de l’asile et de ce qu’il n’appelle pas la folie est, en ce sens, philosophique et poétique.
Il y aurait donc quelque chose de paradoxal à publier ses Œuvres, à lui rendre sous la forme d’un imposant volume ce dont il n’aurait pas voulu. À consacrer auteur celui qui, vers la fin des années 1960, s’empara de l’autisme comme modèle d’une forme d’existence anonyme, dénigrée, reléguée à la frange de tout, et en cela, dit-il, non assujettie, réfractaire à la « domestication symbolique ». À célébrer le nom de celui qui chercha une langue sans sujet, une langue infinitive, débarrassée du « se », du « soi », du « moi », du « il » ; une langue du corps et de l’agir, à la fois concrète et contournée, répétitive jusqu’à la ritournelle, qui cultive l’opacité par peur d’être comprise, mal comprise, prise. L’œuvre de Deligny est justement l’image d’un processus de déprise de soi et de l’Un, dans le travail de l’écriture et dans la recherche indéfiniment remise sur le métier d’uncommun d’espèce, pour faire pièce aux violences du sens de l’histoire.
Deligny partage avec les intellectuels de la deuxième moitié du xxe siècle le refus des fixations identitaires et la pensée métaphorique de la discontinuité : plutôt que de déplacements, de dérivations, de rhizomes ou de prolifération de systèmes, il parle de détours, de repères, de chevêtres ou d’orné. Ce vocabulaire est issu d’une expérience de l’espace vécue au travers des symptômes psychotiques. À Armentières, déjà, il tire parti de la topographie labyrinthique, des espaces à faible légitimité, des caves, des greniers, des trous. Quel que soit son projet, il commence toujours par élire un territoire qu’il veut ample (voire à perte de vue : les Cévennes) et complexe. L’asile, La Grande Cordée, la tentative des Cévennes, sont desréseaux : des antidotes à la concentration des pouvoirs et des identités, une manière d’éviter de « faire cible ». Le détour est une alternative à la « dérive » romantique post-surréaliste ; un parcours rallongé mais limité, qui conserve dans ses boucles la référence à un lieu. Par chevêtres, il faut entendre ces points de repère où le corps rencontre quelque chose ou quelque lieu déjà connu, plutôt que de se perdre dans l’infini d’une pensée trop large et de sensations trop intenses. L’orné qualifie la vision idéalisée, esthétique, de cette appréhension de l’espace.
Les expériences de Deligny sont par définition fragiles, éphémères, et doivent le rester pour rester vivantes. Elles naissent de ruptures dont il se plait à penser qu’elles sont le fruit des circonstances. Associant la formule favorite d’Henri Wallon (« L’occasion fait le larron. ») et l’attrait poétique du hasard, il fait de l’idée de circonstances un véritable mot d’ordre, contre le lien logique de cause à effet. Il définit l’éducateur comme un « créateur de circonstances », prêt à accueillir l’« insu » d’où naissent de nouvelles configurations. Le réseau d’enfants autistes n’est pas une tentative mais plusieurs : la pratique des cartes, le tournage des films, l’organisation des « aires de séjour » sont autant d’essais interrompus ou relancés au bord de l’échec ou de la sclérose. Deligny y voit des « brèches », des « trouvailles », des « percées » : l’euphémisme est l’une de ses figures de style favorites. L’autre est la métaphore. Le radeau évoque l’hétérotopie bricolée grâce au savoir-faire et à la vigilance des personnages hors norme qui l’ont suivi dans ses aventures, Gisèle et Any Durand, Jacques Lin, Guy et Marie-Rose Aubert (pour ne citer que les plus proches) ; il évoque également une forme d’épopée réduite, à la limite du dérisoire, et parfois burlesque, sans commune mesure avec celle des œuvres qu’il admire, celles de Conrad, Melville, Cervantes, Stevenson. Le grand navire de l’asile est déjà un radeau ; l’ex-demeure bourgeoise du Centre d’observation et de triage (COT) de Lille également. Quelle qu’en soit la forme et l’échelle, l’image recouvre la réalité existentielle de ce que François Tosquelles appelle un « appareil à repriser ». Dans cette formule, la connotation artisanale est précise. La critique de Deligny ne porte pas sur la structure matérielle, spatiale et sociale, de l’institution, mais sur l’intégration de normes abstraites qui entravent l’invention, la « masse des possibles », et l’efficacité. Son réflexe de l’« esquive » évoque moins l’évitement que la stratégie qui consiste à tirer parti de la faiblesse de l’adversaire et de la confusion institutionnelle, pour subvertir les règles et confronter l’administration à sa propre corruption.
Son refus des spécialités (autre forme de fixation identitaire) est motivé par le même souci d’efficacité. Profitant du désordre de la guerre, il bouleverse l’organigramme de l’asile (plutôt que la hiérarchie : son meilleur allié est le médecin-chef Paul Guilbert) et intronise les gardiens « éducateurs ». Ce sont d’anciens ouvriers ou artisans : Deligny met à profit leur savoir-faire, leur résistance physique et leur disponibilité. Il se méfie des corporations et de l’allégeance à la technique et aux savoirs constitués. Le motif officiel de sa mise à pied du COT de Lille est le casier judiciaire chargé des moniteurs (ex-ouvriers, militants, syndicalistes, chômeurs). Il encourage l’ironie des « présences proches » – périphrase par laquelle il désigne les non éducateurs en charge des enfants autistes – à l’égard des approches livresques et techniciennes. Pour définir ce parti pris, il parle d’« initiative populaire ». La formule est ambiguë : elle évoque un événement collectif, alors qu’il y est question de « milieu », de l’origine sociale commune aux moniteurs et aux enfants. Son projet n’est pas révolutionnaire : « Je dis tout simplement qu’un radeau n’est pas une barricade et qu’il faut de tout pour qu’un monde se refasse. »
Il est lui-même le reflet de cette dé-définition. S’il écrit en permanence, avec le souci d’être publié, c’est aussi pour se déplacer, pour échapper à l’instrumentalisation, rappeler que la recherche trouve le chercheur au-delà (ou en deçà) de l’image dans laquelle on le fixe, sur le terrain mouvant et fragile de l’expérimentation. Il se désolidarise de l’auteur de Graine de crapule, estampillé « éducateur libertaire », mais continue de s’adresser aux travailleurs sociaux dans une langue volontairement étrange, qui creuse l’écart entre le texte et le destinataire, afin que s’y logent des questions sans réponse. Il écrit à Louis Althusser en septembre 1976 : « Dans notre pratique, quel est l’objet ? Tel ou tel enfant, sujet “ psychotique ” ? Certes pas. L’objet réel qu’il s’agit de transformer, c’est nous, nous là, nous proches de ces “ sujets ” qui, à proprement parler ne le sont guère et c’est pourquoi, ILS y sont, là. » Il renverse l’optique de l’éducation spécialisée, détourne l’objectif de l’enfant pour le braquer sur l’éducateur et plus généralement sur « l’homme-que-nous-sommes ».
À la fin des années 1930 – il est alors instituteur dans les classes spéciales – et au début des années 1940, il s’affilie encore, de loin, à la pédagogie moderne. Celle-ci commence avec le « faire œuvre de soi-même » d’Heinrich Pestalozzi, emprunté à l’idéalisme de l’action de Fichte et plus précisément au concept de Selbsttätigkeit (l’autoactivité, au double sens d’une activité produite par soi et d’une activité sur soi). Deligny figure marginalement dans cette histoire, qui s’adresse à des enfants « normaux », socialisables. Sa vocation est celle des enfants « arriérés, caractériels, déficients, délinquants, en danger moral, retardés, vagabonds, etc., etc. » (Adrien Lomme), et plus tard autistes, pour lesquels la référence psychologique à l’autonomie ne joue pas. « Les aider, pas les aimer » est la formule qui résume sa critique des « idéologies de l’enfance » (Pierre-François Moreau) de l’après-guerre, l’écart entre son approche ironique et mélancolique, et celle, idéaliste et chrétienne, du renouveau éducatif. Le réseau d’accueil et d’apprentissage destiné aux adolescents de La Grande Cordée est un prétexte à susciter de nouveaux événements, à éloigner le terrain pathogène plus qu’à générer de véritables vocations par le travail. Le jeu ou le dessin, autres points cardinaux des pédagogies nouvelles, n’ont pas de prise sur des enfants ou adolescents « désymbolisés ». La sensation du geste dans l’agir improductif, « pour rien », lui paraît garantir la reconstruction d’un corps plus sûrement que l’acquisition de conduites sociales. Il voit très tôt le cinéma comme un outil à mettre entre les mains des adolescents de La Grande Cordée : il imagine un film sans pellicule, une caméra stylo, qui transite d’un lieu à l’autre comme emblème d’un projet commun. Il confie la cartographie des « lignes d’erre » à des autodidactes. Malgré leur séduction graphique, ces transcriptions résistent au statut d’œuvre d’art, brut ou conceptuel. On imagine, dans quelques décennies (ou siècles ?), un chercheur face à ces documents ; il y verrait sans doute la trace de pratiques naïves, légèrement hallucinées, bruissant sous les grands discours du xxe siècle à propos de la folie.
Le domaine réservé de Deligny est l’écriture, directement branchée sur la vie qu’il partage avec les enfants, à distance. Il évite l’image pastorale du pédagogue. Il touche à tous les genres : la chronique, l’essai, la nouvelle, le conte, la prose poétique, le scénario. Un seul lui échappe : le roman. L’échec d’Adrien Lomme est un petit drame, qui ne se reproduit pas. Il cultive une image d’autodidacte qu’il n’est pas. Il dissimule son parcours universitaire, bref il est vrai : celui d’un étudiant contestataire de la bohême lilloise du début des années 1930, amateur de poésie et de cinéma d’avant-garde. Il lit beaucoup sans être de ces lecteurs passionnés pour lesquels la lecture est une seconde vie. Il a quelques œuvres de prédilection (Moby Dick etDon Quichotte) ; il a lu tout Conrad dont il possède les œuvres complètes. Avec le temps, la poésie (Michaux, Ponge, Artaud), occupe moins de place dans ses lectures. Il lit des romans policiers (Simenon et John Le Carré). Dans l’éthologie (les Souvenirs entomologiques de Fabre, Lorenz, Karl von Frisch) il retrouve le plaisir des « histoires ». La biologie l’intéresse davantage que la psychiatrie. Les textes d’Henri Wallon davantage que ceux de Foucault, Deleuze ou Guattari. Sa pratique des textes de sciences humaines est plus intuitive qu’analytique : il lit attentivement Leroi-Gourhan, Lévi-Strauss ou Clastres, mais parcourt Heidegger, Marx, Althusser ou Lacan ; il fait des sondages dans leurs textes, repère ce qui lui est utile ; argumente sur des extraits sans considérer l’ensemble. Sa lecture duDiscours sur la servitude volontaire de La Boétie est précise mais comme toujours orientée par ses propres obsessions. Le personnage de Wittgenstein l’intéresse au moins autant que l’œuvre. Il affiche une désinvolture à l’égard des textes savants ; il donne peu de références, cite de mémoire et dans le désordre.
En 1980, il publie un texte intitulé « Ces excessifs ». Les intellectuels, dit-il, ont des convictions ; ils assimilent la pensée des autres. Il confond intellectuels et idéologues. En choisissant l’asile, il veut renier son appartenanceà la classe des intellectuels petits-bourgeois. L’éducateur, dit-il, est un artisan, un manuel. Certains de ses textes frisent l’obscurantisme. Son refus de « comprendre », synonyme pour lui d’assimiler, de « semblabiliser », fonde son rejet massif de la psychanalyse. Son père est tué et porté disparu en 1917 ; l’enfant Deligny est pupille de la Nation. Il place sa première autobiographie, Le Croire et le Craindre, à l’enseigne du soldat inconnu. Il cultive l’idée d’anonymat plus que l’anonymat. Au début des années 1970, il devient un personnage de référence ; il a presque soixante ans ; son écriture témoigne d’une distance à l’égard des utopies (antipsychiatrie, communautés thérapeutiques, retour à la nature) dont il peut paraître l’emblème ; Graine de crapule et Les Vagabonds efficacessont encore lus et le créditent d’une autorité ; il est resté communiste tout en clamant son antihumanisme et sa critique de l’institution ; il se tient à distance du gauchisme fusionnel et bavard d’après Mai 68. Sa position intrigue et intéresse les intellectuels ; ils lui rendent visite, le sollicitent, confrontent leurs théories à son « terrain », leurs discours à son respect du silence. Ils vérifient auprès de lui l’échec de la critique frontale des pouvoirs et des savoirs ; testent les fondements de son rejet de la psychanalyse, au temps du Psychanalysme et de L’Anti-Œdipe ;s’interrogent sur sa pensée « inabsorbable » (Althusser) d’un individu non sujet, hors d’atteinte de l’idéologie ; mesurent leurs ambiguïtés politiques et institutionnelles à l’aune de son refus des compromissions.
La forme de son écriture confirme sa méfiance à l’égard des discours. Il privilégie les formes brèves. L’aphorisme est sa formule de base ; aprèsGraine de crapule, il l’adapte à l’ensemble des essais. Ses paragraphes sont courts, séparés de longs blancs qui tiennent lieu des scansions d’une pensée à voix haute, avec ses accentuations, ses retours, ses ellipses, ses répétitions. Les digressions infiltrent ses textes de plusieurs manières. À partir des années 1960, il fait référence au dictionnaire et à l’étymologie de façon quasiment systématique : moins pour rappeler le vrai sens que pour le déplier, pour dévier le cours du texte, articuler des réflexions et quantité d’anecdotes qui fondent la légende de son personnage, son roman et celui du réseau. Les fragments d’autobiographie surviennent sur le mode de l’association ; ils signalent une activité psychique permanente, une perméabilité de la pensée spéculative à l’image – la moindre image –, à ces petites unités que Deligny appelle « bribes », « copeaux », « débris », en référence à l’humain « en reste » et à la fragmentation de la perception autistique.
Tels sont l’activité et le style de Deligny, aux aguets des circonstances etinscrits sur le fond d’une permanence qui lui est nécessaire. Géographiquement, son parcours se partage en trois zones et trois moments : l’asile d’Armentières et ses activités à Lille dans le cadre de la Sauvegarde de l’enfance ; La Grande Cordée dont le premier épisode eut lieu à Paris et les suivants à travers l’est et le sud-est de la France ; le hameau de Graniers, dans les Cévennes, où il vécut pendant trente ans, sans en bouger, de 1968 à sa mort. Il n’a jamais quitté la France, ne parlait aucune autre langue que la sienne, ne regretta en rien l’expérience de cetteétrangeté-là. L’étrangeté, il la chercha ailleurs, à l’asile et au Parti communiste. Inscrit aux jeunesses communistes en 1933, il conserva sa fidélité au PCF jusqu’à sa mort (c’est à L’Humanité qu’il donna son dernier entretien, en juillet 1996). De militant, dans le contexte de son activité d’éducateur, à Lille, puis dans l’après-guerre pendant La Grande Cordée (dont tous les membres, sauf un, sont communistes), il devint à partir des années 1960 un compagnon de route plus lointain. Ses textes d’alors révèlent une véritable hantise des idéologies. La pensée du commun est un antidote au « social », qu’il définit désormais comme la promotion et « la prolifération des privilèges ».
L’histoire le lâcha et il lâcha l’histoire au début des années 1960. Le moment coïncide avec la fin de La Grande Cordée et, symboliquement, avec la mort d’Henri Wallon : le seul, parmi les communistes intransigeants de l’association, qui admît son indépendance, son « communisme très, très insuffisant ». Il est déchiré entre un refus viscéral de l’anticommunisme, et un désaccord profond avec le conditionnement idéologique du PCF. À la même époque, il abandonne la prise en charge des adolescents et entame, hors tout appareil institutionnel, une recherche sur les formes de langage non verbal. Sa rencontre en 1966 avec Janmari, « encéphalopathe profond », le détourne définitivement de l’engagement et de l’histoire, et le réconcilie avec lui-même. L’autisme profond de cet enfant-là, son retrait absolu du langage et son charisme éveillent en lui une vocation que n’aurait sans doute éveillée aucun autre enfant. Il voit en ce « jumeau de Victor de l’Aveyron » la marque de la permanence de l’espèce, le signe d’une humaine nature sans manque, débarrassée de la tyrannique réciprocité du désir, unindividu inné, étranger à l’angoisse de la mort.
L’œuvre de Deligny est hantée par la trace. Il la suit, d’expérience en expérience, par touches. Il ne cherche pas l’objet de la trace (il a disparu). L’humain, le reste, n’est qu’une trace. Elle circule dans son œuvre sous la forme de la ligne, de l’écriture ou de l’image ; quand elle s’efface, c’est pour être reprise, indéfiniment reprise, dans un présent toujours renouvelé, toujours là. Le tracer infinitif est la forme accomplie de cette permanence qui ne renvoie à rien d’autre, à aucun Autre. La performance des vingt-six versions et des deux mille cinq cents pages manuscrites de L’Enfant de citadelle associe l’autofiction, dégagé du travail d’anamnèse, et l’absorption de l’histoire dans une trace sans fin ni destinataire.
***
Ce recueil paraît un peu plus de dix ans après la mort de Deligny, quand tous ses livres (hormis Graine de crapule, Les Vagabonds efficaces, et les derniers aphorismes, Essi et Copeaux) sont épuisés. Il rassemble pour la première fois l’essentiel de son œuvre : de Pavillon 3, son premier livre, paru pendant la Seconde Guerre mondiale, aux textes sur l’image des années 1980. Il s’achève (en forme d’invite) sur quelques pages manuscrites de sa dernière et monumentale tentative, L’Enfant de citadelle. Au fil de ces mille huit cent cinquante pages, Deligny reste ce qu’il fut, un instituteur, un éducateur, un intellectuel sans discipline assignée, un inventeur.
Le temps et la connaissance incomplète de son œuvre ont fixé un malentendu : il y aurait un Deligny éducateur, militant de la Sauvegarde de l’enfance et communiste, et un Deligny plus spéculatif, « poète de l’autisme », réfugié dans les Cévennes à l’abri des luttes institutionnelles. Cette séparation est grossière ; elle tient à l’hermétisme des disciplines et à la survivance de préjugés contre l’« art » comme institution ou domaine esthétique. Elle tient également à une donnée (acceptée et acceptable dans les années 1970) que notre époque refuse : Deligny parle d’autisme sans être psychiatre ; pire, peut-être, il accueille des autistes sans intention de les guérir. « Il aménageait la vie d’autiste » dit-on de lui. Les périphrases (mutisme, vacance du langage, etc.) ne font que compenser nos difficultés à reconsidérer les frontières entre le normal et le pathologique. Il s’est toujours agi pour Deligny de faire « cause commune » avec des enfants (ou adolescents), de leur éviter la prison ou l’hôpital psychiatrique, la souffrance, l’inhumanité de la réclusion ; d’adopter leur point de vue plutôt que celui des instances éducatives, médicales ou juridiques ; de définir un milieu adaptatif plutôt qu’un ensemble de règles abstraites ; de préférer l’invention à la compassion philanthropique, ou au narcissisme des « marges » des années 1960 célébrées par une intelligentsia très urbaine et éloignée des réalités. Il ne s’agit pas pour autant de sous-estimer l’intérêt de sa stratégie institutionnelle au COT de Lille ou durant La Grande Cordée ; ou de réinterpréter, comme il a tendance à le faire lui-même, ses tentatives des années 1940 à la lumière de son rejet du langage.
« Journal d’un éducateur », paru dans le premier numéro de la revueRecherches fondée par Félix Guattari, est le premier signe de ce désaveu de l’histoire. La chronologie du récit est cassée, les épisodes de l’asile, la guerre et le Parti communiste, éclatés et absorbés dans une perception sans référence au temps et à l’espace, annulés dans l’expérience de la folie et de la mort. Ce texte sert de prologue au recueil. Deligny l’écrivit en 1966, à la clinique de La Borde. Il avait cinquante-trois ans ; il avait déjà passé trente ans avec des enfants et adolescents arriérés et caractériels ; il en passera trente autres avec des enfants autistes.
Asiles
La présentation chronologique de ses œuvres a l’avantage d’ordonner un matériau complexe de textes, articles, numéros de revues, dessins, cartes, photographies, films. La profusion est la marque d’une œuvre expérimentale qui vise le geste et l’activité plus que l’objet. Le recueil est composé de cinq parties. La première, « Asiles », porte sur dix ans d’activité et de publications. D’instituteur dans les classes spéciales à Paris, Deligny devint éducateur, à Armentières, pendant la guerre. L’Association régionale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (Arsea) le missionna ensuite pour prendre la direction d’un plan de prévention de la délinquance, puis celle du premier COT de Lille. Il se distingue aussitôt par ce que Michel Chauvière appelle une « triple dissidence » : à l’égard du régime éducatif, du mode de recrutement des éducateurs et de la division du travail entre les institutions habilitées. Son premier livre, Pavillon 3, paraît en 1944. L’éducateur-écrivain n’a pas encore trouvé son style ; l’écriture hésite entre une prose poétique surchargée de métaphores et la langue parlée. Sa tentative d’écrire pour des adolescents délinquants, épileptiques, psychotiques, est maladroite ; mais il faut la considérer comme un témoignage sur l’internement asilaire dans le milieu du prolétariat. Le roman social et populiste des années 1930 – auquel s’apparente Pavillon 3 – écartait du tableau de la misère humaine les « voix d’en bas » qui n’ont rien à faire valoir, ni force de travail, ni capacité de lutte, ni droit moral.
La parution de Graine de crapule, en 1945, attira l’attention sur cet éducateur dont la voix s’élevait contre la Sauvegarde de l’enfance mais également contre l’esprit paternaliste et « protectionnel » (Dominique Youf) de l’ordonnance de 1945. La préface inédite (1955), prévue pour une première réédition, montre la réticence de Deligny à l’égard des aphorismes qui l’ont rendu célèbre. Il critique ses propres « formules » paradoxales ; y apparaît un personnage fragile, hanté par ses origines sociales, et par une sensibilité littéraire qui, dit-il, l’éloigne du peuple. Il convie l’éducateur à « traquer dans les phrases […] l’adroit petit-bourgeois », le « charlatan de bonne volonté ». Les Vagabonds efficaces, chronique de son séjour au COT de Lille, parut trois années après Graine de crapule, en 1948. Le réquisitoire contre la société qui juge et enferme est violent, révolté par l’écart entre la misère des « taudis » et l’abstraction institutionnelle. Deligny met en garde les premiers éducateurs contre la normalisation et l’emprise de la morale qui masquent la cause sociale de la délinquance. Les Vagabons efficacesconfirme sa réputation d’éducateur-écrivain, fait exceptionnel pour l’époque. Les contes des Enfants ont des oreilles publiés en 1949 au Chardon rouge, éphémère maison d’édition fondée par Deligny et Huguette Dumoulin, rappellent qu’il fut également instituteur, partisan distant des méthodes d’éducation nouvelle. Le jeu de la mise en page, l’utilisation du dessin, donnent du personnage un nouvel aperçu : sa fantaisie grinçante, son parti pris des choses « au rebut » (l’anti-conte de fées). La reproduction en fac-similé rend compte de l’originalité de ce petit objet. Nous l’avons jugé plus significatif que Puissants personnages, (paru trois ans plus tôt), sorte de conte ou de fantaisie troubadour, rêverie palliative, peu consistante au dire de Deligny lui-même.
La Grande Cordée
La deuxième partie porte le titre de l’association « de prise en charge en cure libre » fondée en 1948, La Grande Cordée. Avec Les Vagabonds efficaces, Émile Copfermann, éditeur chez François Maspero, réédita trois articles de Deligny qui décrivent l’expérience sous différents angles. Nous les reprenons, avec la préface de Copfermann, de préférence à d’autres moins synthétiques et plus techniques, parus dans les revues institutionnelles, Sauvegarde de l’enfance ou Rééducation. Pendant cette période, Deligny écrit peu. Il consacre tout son temps à la survie de l’association, qui se heurte au secteur dominant de l’enfance inadaptée, à la prévalence « du diagnostic et du pronostic » (Annick Ohayon), et à l’inertie calculée de la Sécurité sociale. Les débuts de la guerre froide affaiblissent le PCF dont sont membres tous les fondateurs de La Grande Cordée. En 1955, il quitte définitivement Paris pour une période instable de dix ans. Le témoignage précis d’Huguette Dumoulin, cheville ouvrière majeure de l’association, et la correspondance de Deligny avec Irène Lézine, communiste intransigeante et biographe d’Anton Makarenko, ont permis de reconstituer les étapes de la « diaspora » de La Grande Cordée en milieu rural ; comme celles, parallèles, de l’écriture d’Adrien Lomme, le seul livre de Deligny paru dans les décennies 1950 et 1960, et son seul roman. La difficulté à maîtriser la fiction et la distance qui le lie aux personnages le fera renoncer au genre ; la dénonciation des approches de l’éducation spécialisée et du « mythe psychiatrique » est trop amère pour être objectivement prise en compte ; mais, un peu à la manière de Pavillon 3,Adrien Lomme restera une chronique romancée de l’arriération dans les campagnes françaises après la guerre, et de l’impuissance des structures de prise en charge, privées comme publiques.
Les Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active (Ceméa) furent, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’un des instruments de cette « autre politique » (Pierre-François Moreau) qui se substitue à celle de l’État en matière d’éducation, de culture, et de santé mentale. Les Ceméa offrent à Deligny leur réseau et leur logistique, se proposent de faire connaître La Grande Cordée ; ils s’identifient à ses projets, font de son personnage l’un des emblèmes de leur programme. Les quelques documents et commentaires rassemblés ici résument un état d’esprit : le culte du groupe, du corps, de la vie de plein air, de l’amitié ; les stages, les activités manuelles, la lutte pour l’amélioration des conditions de vie des malades mentaux, Jean Vilar, le Théâtre d’Avignon… L’histoire de Deligny a croisé celle des Ceméa ; mais il ne partage pas plus leur humanisme chrétien qu’il n’adopte la perspective de l’homme nouveau d’Anton Makarenko. « Il ne croyait pas beaucoup en l’action collective », dit de lui Jacques Ladsous.
Légendes du radeau
Les six cents pages de la troisième partie forment le centre du recueil. Elles relatent les années les plus expérimentales et les plus inventives du réseau d’enfants autistes. Après le tournage du Moindre geste, Deligny passe deux ans à La Borde, invité par Jean Oury et Félix Guattari. Il est mal à son aise dans « l’univers concerté et parlé » (Anne Querrien) de la clinique. Il réalise les trois premiers numéros des Cahiers de la Fgéri(Fédération des groupes d’études et de recherches institutionnelles), avec un sens inspiré du bricolage graphique (à partir du numéro 4, auquel il ne participe pas, les Cahiers deviennent une suite de discours militants). Ces carnets de notes, publiés de manière confidentielle en marge de la revueRecherches, sont sa seule participation à l’effervescence « groupale » des années 1967-1968, autour de Félix Guattari et de la psychothérapie institutionnelle. Le numéro 2 contient un texte important, « Langage non verbal », qui formule de manière encore tâtonnante les modalités conceptuelles et pratiques du futur réseau d’enfants autistes.
Les ouvrages suivants, Nous et l’Innocent, les trois Cahiers de l’Immuable(intégralement reproduits en fac-similé) et Le Croire et le Craindre, publiés entre 1975 et 1978, ont vu le jour grâce à Isaac Joseph. Nous et l’Innocentest le premier ouvrage de Deligny depuis Adrien Lomme, et le premier des quatre livres publiés par Émile Copfermann dans la collection « Malgré tout » chez Maspero. Deligny a définitivement rompu avec le militantisme social. Il vit dans les Cévennes, près de Monoblet, depuis 1968. Il engage une nouvelle tentative avec des enfants autistes et entame sa longue croisade contre le langage. Il invente un dispositif spatial, des coutumes, une cartographie, une langue. Les Cahiers de l’Immuable livrent une chronique en temps réel du réseau, en donnant une large place aux tracés et à la photographie. Isaac Joseph convoque des interlocuteurs, replace la pensée de Deligny au cœur des débats intellectuels autour de la psychiatrie. Dans les mêmes années, Renaud Victor réalise Ce Gamin, là. Le succès du film complète la « publicité » du réseau et relance les débats sur la prise en charge de l’autisme dans le milieu du travail social.
Deligny continue d’écrire, incessamment. Isaac Joseph trie, structure, rassemble des textes épars, des extraits de correspondance et d’entretiens. Il en tire la première autobiographie de Deligny, Le Croire et le Craindre. Son émouvante postface le montre aux prises avec les contradictions de l’auteur ; il est l’un des seuls à le penser comme un écrivain et à le replacer dans une histoire contemporaine de la philosophie et de la littérature (Deleuze, Duvignaud, Hermann Hesse) ; en pleine période de « récupération » des expériences alternatives, il l’appelle au secours des travailleurs sociaux. En préambule à Le Croire et le Craindre, nous publions un court texte inédit, qui explicite les deux mots du titre, « Croire » et « Craindre », et annonce les thèmes de la décade suivante. Deux ans plus tard la publication de I Bambini e il silenzio aux éditions Spirali (dirigées par Armando Verdiglione), associe Deligny aux Lacaniens et à l’antipsychiatrie italienne. Le recueil est repris la même année en français : Les Enfants et le Silence contiennent (comme la version italienne) un ensemble d’articles pour la revue Spirali et la reprise intégrale des textes des Cahiers de l’Immuable/3. Parallèlement, il publie dans la revue Spirales (antenne française de Spirali) avec John Cage, Noam Chomsky, Jean Oury, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Philippe Sollers, Thomas Szasz, François Tosquelles… Nous aurions voulu reprendre quelques-uns de ces textes. Nous y avons renoncé faute de place ; comme nous avons renoncé, provisoirement, à publier un inédit de la même époque (« Quand le bonhomme n’y est pas », 1978) qui confirme les affinités de la pensée de Deligny avec celle de Lacan, quant à la notion de réel.
L’agir et le faire
Entre 1978 et 1983, Deligny publie sept livres. Nous en avons retenu trois, édités coup sur coup par Émile Copfermann chez Hachette, dans la collection « L’échappée belle » : Les Détours de l’agir ou le Moindre geste,Singulière ethnie et Traces d’être et Bâtisse d’ombre. Avec Projet N, le film réalisé par Alain Cazuc, les trois livres composent la quatrième partie ; ils furent pilonnés quelques mois après leur parution et sont donc quasiment inédits. Cette trilogie concentre la part la plus spéculative de la pensée de Deligny. Il s’appuie sur l’ethnologie (Lévi-Strauss et Clastres) et la critique de l’ethnocentrisme pour redire (à propos de l’autisme et à la suite des camps de concentration dont il ne parle jamais directement) son rejet de la discrimination entre « espèces vivantes humaines et non humaines » (Lévi-Strauss) ; pour articuler « la reconnaissance de la déficience et la pensée d’une nature humaine » (Bertrand Ogilvie) ; pour invoquer, enfin, moins le retour que la présence éternellement ressuscitée d’un antan pacifié, lumineux, temps des pierres et des traces. Dans sa postface à Traces d’être et Bâtisse d’ombre, s’inspirant de Heidegger et Jean Giono, Jean-Michel Chaumont situe l’antan de Deligny du côté de la tradition (et non des ancêtres), d’un temps abstrait et non personnifié.
En 1980 paraît Traces d’I, un ouvrage en deux parties, dont Jean-Michel Chaumont est l’auteur des cent vingt premières pages ; les textes de Deligny traitent des mêmes thèmes que ceux de la « trilogie Hachette ». Nous avons privilégié la cohérence de la trilogie, ce qui était aussi une manière de saluer le travail d’éditeur d’Émile Copfermann. Celui-ci publiait la même année un quatrième livre chez Hachette : La Septième face du dé, étrange autofiction interprétée par Roger Gentis comme une métaphore de l’« impensable psychotique ». Malgré la singularité du récit, et les clefs qu’il livre entre les lignes sur la hantise de la disparition du père, nous avons renoncé à le rééditer. Le retour au décor de l’asile et la reprise d’une écriture narrative et réaliste auraient alourdi la structure du recueil.
Entre 1980 et 1985, Deligny écrit quatre essais de plus, d’inégale importance et tous inédits : L’Arachnéen, et Lointain prochain constitué deLettres à un travailleur social, Les Deux mémoires, et Acheminement vers l’image que nous publions dans la cinquième partie. « L’arachnéen » (ou, si l’on veut, l’être a-conscient) accomplit la métaphore du réseau selon une définition éthologique : une forme complexe, innée, ritualisée, agie sans vouloir, anti-utilitaire ; qui procède de l’entrevision, dit-il, citant Vladimir Jankélévitch.Les thèmes (agir, vouloir, pouvoir) sont voisins de ceux deSingulière ethnie et l’approche visionnaire anticipe celle de Traces d’être et Bâtisse d’ombre. Le cas de Lettres à un travailleur social est différent. Deligny ne se reconnaît pas dans les questions des travailleurs sociaux ; il se définit comme « poète et éthologue ». Il mobilise Wittgenstein, la philosophie des faits, du tacite, de l’innommable. Il reprend la métaphore de l’asile : « asiler l’individu », dit-il, plutôt que « materner le sujet ». Il vise encore une fois la psychanalyse, son confort et son assujettissement à la norme du langage. « Éloge de l’asile » et « A comme asile », deux essais complémentaires (parus en 1999), sont de la même veine.
Ce qui ne se voit pas
La cinquième et dernière partie du recueil est constituée de deux textes inédits et d’un film peu connu, Fernand Deligny. À propos d’un film à faire. Deligny s’achemine vers une pensée de l’image-trace, enregistrée dans la mémoire d’espèce, une « vera iconica délivrée de l’emprise du regard » (Jean-François Chevrier). Il est âgé. Sa pensée est de plus en plus abstraite et de plus en plus éthérée. Il écrit « Camérer » (dont il existe plusieurs versions) et Acheminement vers l’image, un essai de toute première importance, qui place sa réflexion au diapason de celle des grands cinéastes contemporains : Marguerite Duras, Jean-Luc Godard, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, pour qui l’image n’a lieu qu’à condition de toucher au réel, et pour qui le réel est inséparable de la réalité des faits politiques, c’est-à-dire d’un ensemble de rapports de pouvoir. Inédit jusqu’à ce jour,il révèle un Deligny « moderne », prenant place et position dans une histoire de l’image qui commence avec les avant-gardes. Il cite Jean Epstein. On découvre qu’il a aimé le cinéma de Man Ray, alors qu’on le croyait exclusivement du côté des Russes ou de l’ontologie bazinienne. Mais l’image garde pour lui quelque chose d’enfantin, de primitif ; la manière dont elle apparaît tient pour lui de la réminiscence, de l’infraverbal, de l’éblouissement silencieux de la lanterne magique.
Plutôt que de publier un second texte inédit (Les Fossiles ont la vie dure) qui développe les thèmes d’Acheminement vers l’image, nous avons pris le parti de lui associer les extravagantes « enluminures » des Contes du vieux soldat et de belle lurette, écrit dans les mêmes années, et également inédit. Deligny a écrit une vingtaine de contes, et plus si l’on tient pour des contes quantité de petites nouvelles à valeur de parabole. Accompagné de sa « tribu » (l’araignée, le boulet, la Maritorne, le marin norvégien, etc.) le vieux soldat des Contes part à la recherche de sa ville natale où l’attend un « emploi réservé ». On retrouve dans un genre hybride et inventé, qu’on pourrait qualifier de « merveilleux trivial », les thèmes des essais. On reconnaît également, quarante ans après Les Enfants ont des oreilles, l’empathie de Deligny pour les choses au rebut, son goût d’un burlesque chaplinesque, et le rêve de l’éternel retour.
Le recueil des œuvres de Deligny s’achève sur une vingtaine de pages manuscrites de L’Enfant de citadelle. L’écriture est fine et cursive, pressée par le temps et la poussée de la mémoire. Elle s’adresse à « qui-me-lit », la mère peut-être, Louise, morte en 1950, dont le soliloque (« Louise était les autres […] Louise était innombrable… ») a comblé et envahi l’enfant pendant leur séjour imaginaire à la citadelle Vauban. Autour d’elle une théorie de personnages surgis de la guerre, de l’asile, des années d’enfance à Bergerac et d’adolescence à Lille. Le manuscrit est inachevé. Il n’est pas le dernier. Avant de mourir, le vieil éducateur, assis devant la fenêtre de sa chambre de Graniers, écrit ses derniers aphorismes, Essi (Et-si-l’homme-que-nous-sommes) et Copeaux (récemment parus).
***
Sans compter L’Enfant de citadelle, Deligny laisse environ trois mille pages inédites. Que sont ces pages ? Des essais, des récits, des scénarios, des pièces de théâtre, des contes, de la correspondance. Tout ne méritait pas la publication. La correspondance est immense. Nous n’avons eu accès qu’à celle qui commence dans les années 1950, avec La Grande Cordée. Deligny ne s’y confie guère. Tout se passe comme si sa vie privée ne l’intéressait (ou n’intéressait l’interlocuteur) qu’au travers de quelques faits : untel est venu, untel est parti, untel est né ; nous allons bien ou mal, sommes de plus en plus pauvres, ou satisfaits d’avoir reçu la caméra. Il conçoit plutôt la correspondance comme une suite à ses échanges intellectuels : avec Louis Althusser, Jacques Nassif, Isaac Joseph, Jean-Michel Chaumont, Marcel Gauchet. Sa correspondance avec Émile Copfermann, son éditeur, avec Françoise Dolto ou d’autres médecins en charge des enfants en séjour dans les Cévennes, est à peine plus circonstancielle. Il écrit régulièrement aux parents des autistes, parle avec précision de chaque enfant et continue d’argumenter sur ses « positions » (c’est l’une des contradictions soulevées par Isaac Joseph : « l’homme sans convictions » est un prosélyte). La correspondance est donc un complément précieux de ses textes, mais l’espace manquait pour la publier ici. (Celle avec Althusser est particulièrement riche, mais on ne dispose pour l’instant que des lettres de Deligny.)
Nous ne donnons pas les « Œuvres complètes » de Fernand Deligny ; nous proposons une sorte de bréviaire substantiel. Les images y occupent une grande place. Elles reflètent l’intérêt que Deligny leur porte depuis toujours, moins en tant qu’« objets » (il n’est pas ce qu’on appelle un « amateur d’art »), que comme medium d’expérimentation. À la première occasion, il s’essaie au dessin, aux jeux typographiques et à la mise en page. Il réalise lui-même les Cahiers de la Fgéri, et les Cahiers de l’Immuable avec Isaac Joseph et Florence Pétry. L’investigation de la ligne, du trait, du tracé, procède pour lui comme pour Michaux d’une expérience dedéconditionnement. À la fin des années 1950, il découvre, au cours de ses séances de dessin avec Yves G., la possibilité de contenir par le trait le monologue sempiternel du psychotique. L’idée dérive progressivement jusqu’aux « lignes d’erre », qu’il considère comme sa principale invention. Deleuze et Guattari les placent à l’origine du concept de rhizome. LesCahiers de l’Immuable/1 s’ouvrent sur la cartographie : les reproductions sont accompagnées de légendes allusives de Deligny. Pour lui il s’agit de « voir » et non de comprendre. Ce système de transcription est codé mais déchiffrable. La plupart des cartes ont été perdues. Nous en avons rassemblé quelques-unes parmi celles qui ont survécu : leurs qualités proprement graphiques révèlent la part de simulacre et de sublimation d’une pratique qui prétend exorciser le langage.
La photographie, autre trace, intéresse également Deligny. Elle fixe l’image sans l’objectiver. Elle appelle des légendes. Comme les cartes, elle lui permet de « voir », à distance (il ne se rend pas sur les aires de séjour). Quatre films ont été réalisés à propos des tentatives de Deligny ; ils font partie intégrante de son œuvre. Il fallait les montrer, pour leur valeur de documents, mais également en tant que films, selon une forme qui évoque autant que possible la leur, leur progression narrative, leur rythme, le montage, la fonction du son et de la voix, le texte de la voix. Le Moindre geste est un film plastique, envahi par la présence du corps d’Yves G. et celle du paysage des Cévennes. La complexité du montage et la diversité des focales appelaient une mise en page dense et mouvementée, la lumière des blancs et des noirs forts. Le monologue du personnage colle physiquement aux images ; le texte, transcrit mot à mot, est en soi un morceau d’anthologie. Ce Gamin, là est aussi linéaire et silencieux que Le Moindre geste est baroque et bruyant ; aux avatars de la fiction succède le calme d’un document idéalisé, centré sur Janmari. L’image est peu contrastée, d’un lyrisme absorbé, soutenue par la voix de Deligny. Projet N,suscité par une commande de l’INA, est, des quatre, le seul reportage classique, en couleur. La mise en page met l’accent sur quelques séquences descriptives, qui font du film un précieux outil d’analyse du mode de vie du réseau. La mise en page d’À propos d’un film à faire est composée sur deux registres, correspondant à l’utilisation respective du noir et blanc (dévolu aux bribes de fiction) et de la couleur (Deligny assis dans son bureau, livrant ses dernières réflexions sur les rapports entre langage et image). Au fil des quatre films l’image « qui ne se voit pas », « ne se prend pas », se retire dans l’imagination et la mémoire de l’écrivain-conteur, pour retourner dans les plis de l’écriture tracée de L’Enfant de citadelle.
***
Textes et films sont précédés d’introductions qui les situent à l’intérieur de la trajectoire de Deligny. Accompagnées de la première véritable chronologie de son œuvre, d’une bibliographie exhaustive, d’une iconographie documentaire et librement interprétative, elles tracent la biographie d’un personnage. Sans chercher à défaire la part de légende qu’il a volontairement entretenue, ces introductions rétablissent une partie des faits historiques sur le fond desquels son action et son œuvre apparaissent. L’enjeu de ce recueil est d’exposer une activité portée par une imagination constante, la faculté d’adaptation d’une pensée confrontée à des situations d’urgence (« tirer d’affaire des enfants fous ») et un ensemble d’objets littéraires et d’images. L’œuvre porte la marque de cette double exigence. Le rassemblement de ses textes ne révèle pas un « grand » écrivain. Deligny renonça assez tôt à le devenir. L’entrée en littérature était incompatible avec l’investissement et les risques quotidiens de la prise en charge, institutionnelle ou non.
Deligny a pris le risque de l’expérimentation et de l’échec. Il a défait pour rendre visible. Le temps, l’attente d’une image juste (ou d’une situation juste : sa morale des « circonstances »), résument sa recherche d’un mode d’être. Dans les années 1960, il propose des alternatives au culte du collectif et de la liberté d’expression, dans lequel il voit poindre l’hypostase du sujet psychologique et consumériste : cet « autre » dont on flatte la « différence » pour différer le trouble de ne pas être soi, et dont on recueille la parole pour masquer l’inhumanité de la société libérale. Ses propositions d’alors sont délibérément à contre-courant de l’histoire. Il critique la démocratie (« la délibération reproduit de l’institution », dit-il) et les droits de l’homme. Il leur oppose sa « singulière ethnie », comme outil de réflexion et non comme modèle. Dans les pratiques du réseau il a recours à l’art, qu’il définit comme un geste pour rien et comme une mémoire des formes. À l’époque de la déterritorialisation et du non-lieu, il restaure la notion de territoire ; mais un territoire non identitaire, un lieu où vivre, se repérer dans l’espace, éprouver son corps et étranger l’autre. Contre l’illusion libertaire de Mai 68, il propose de restaurer le principe d’autorité : une autorité fondée sur la reconnaissance et sur l’efficacité. Deligny était un homme d’ordre, dit de lui Jacques Allaire. L’actualité de Deligny est donc sa permanente inactualité : le repère de l’humain lui permet de penser et d’agir en avance sur son temps.
Ces partis pris sont issus d’une critique du langage qui a conduit Deligny à vivre avec des enfants autistes. Il a justifié son refus de toute forme d’échange par la parole ou le regard (ce que Geneviève Haag, spécialiste des psychoses infantiles, appelle la « rencontre dans le regard », supposée amorcer la reprise d’une relation et la stabilisation de l’axe du corps) en plaçant le réel au-dessus de tout, dans une constellation de perceptions hallucinées, sans correspondances dans l’inconscient. Une telle approche n’a pu se développer qu’à partir de l’observation d’autistes profonds, atteints de troubles tels que l’accès à la parole était définitivement compromis. Les enfants revenaient apaisés de leurs séjours dans les Cévennes : toutes les familles, sans exception, l’ont reconnu. L’apaisement des souffrances de Janmari, le fait qu’il pût vivre non pas sa vie mais une vie, sont inscrits entre les lignes de ce livre.
(Tous droits réservés)