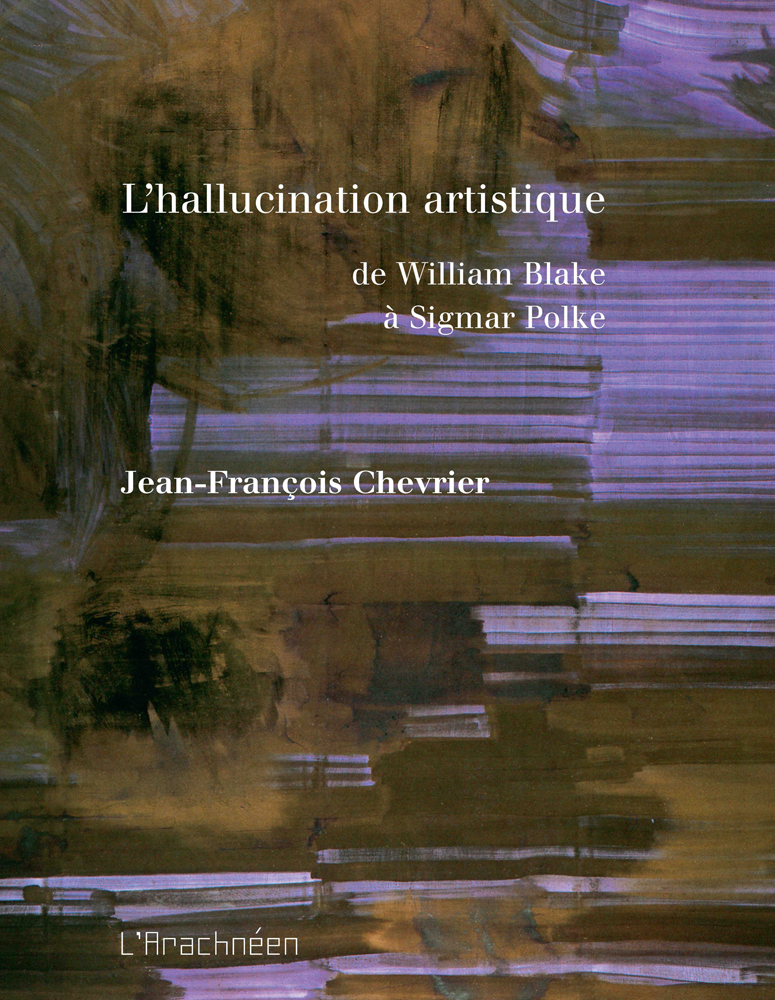
48 €
688 pages
189 images (en couleur)
Format : 22×17 cm
Couverture rigide
ISBN : 978-2-9529302-9-1
Date de parution : septembre 2012
Télécharger quelques doubles-pages du livre.
Avant-propos
Ce livre s’intéresse à la pensée des images et en images au temps de l’hallucination, c’est-à-dire depuis que les aliénistes puis les psychiatres ont entrepris l’étude systématique d’un phénomène qui leur paraissait le symptôme clé de la « folie ». En tant que phénomène pathologique, l’hallucination et l’activité hallucinatoire ont donné lieu à d’innombrables descriptions. L’hallucination est irruption, interruption ; l’activité hallucinatoire se développe dans une durée biographique, elle procède d’un délire. Dans le domaine et le vocabulaire de l’art, la pathologie cède au pathos ; la souffrance est un mode d’expérience qui génère des formes. L’activité hallucinatoire varie selon les biographies et les œuvres. Mon propos ne s’insère pas dans le champ d’études dénommé « art et folie » ; je n’ai pas cherché à faire une nouvelle histoire de l’art dit « psychopathologique », ni celle de l’alternative constituée par l’« art brut ». En examinant des œuvres et des parcours spécifiques, je m’intéresse à un phénomène qui éclaire les ressorts psychiques de l’activité artistique en général, du moins depuis le romantisme.
Dans le domaine littéraire, la teneur psychopathologique du récit fantastique depuis Hoffmann et Edgar Poe a été largement reconnue et analysée. On a montré comment le modèle de l’hallucination s’est diffusé dans la culture du dix-neuvième siècle par un jeu d’emprunts réciproques des écrivains et des psychiatres ; le phénomène se retrouve dans « l’imaginaire des drogues » (Max Milner), de Thomas De Quincey à Henri Michaux. Il fallait poursuivre l’enquête et l’élargir aux arts visuels des deux siècles passés, cinéma compris, et cela au-delà des problématiques et répertoires institués.
L’Hallucination artistique fut d’abord un projet d’exposition. Il s’agissait de prolonger une recherche sur les effets de la poétique mallarméenne dans les arts visuels, qui avait donné lieu à une large présentation en 2004-2005, au Musée d’art contemporain de Barcelone puis au musée des Beaux-Arts de Nantes. En étudiant l’œuvre d’Odilon Redon et sa réception critique, il m’était apparu que l’hallucination avait été reconnue et même invoquée dès le dix-neuvième siècle comme un stimulant et un modèle de l’imagination poétique et artistique. Le noyau initial du cubisme (Picasso, Braque) et ses interprétations, Duchamp compris, constituaient le pivot de l’enquête sur « l’art moderne selon Mallarmé ». J’ai souhaité examiner une autre orientation : les effets et les précédents de la méthode visionnaire préconisée par Rimbaud. À vrai dire, les deux voies se recoupent.
La notion d’hallucination artistique a été avancée en 1866 par un écrivain, Flaubert, qui se disait « artiste » : il répondait à une enquête de son ami Hippolyte Taine, qui s’interrogeait et l’interrogeait sur les ressorts psychophysiologiques de l’imagination littéraire. L’expression désigne pour Flaubert l’emprise dont procède l’activité mentale de l’écrivain quand il est entièrement absorbé dans son travail, quand il voit ses personnages, les entend, quand tout ce qu’il imagine, objets, paysage, décor, lui est devenu plus présent que son environnement actuel ; quand le tableau hallucinatoire s’est substitué aux données et au champ même de la perception. Le phénomène, explique Flaubert, est similaire à l’hallucination pathologique ; il connaît les deux états, mais l’écart, dit-il, est immense. Terreur et torture, d’un côté, joie et extase de l’autre. Le contraste exacerbe l’ambiguïté du phénomène hallucinatoire, tel qu’il apparut au temps des sciences positives : pathologie ou exercice hyperbolique de l’imagination, aliénation ou folie ordinaire, cauchemar du disparate ou puissance constructive du délire.
L’hallucination a évidemment existé avant d’être placée au centre de l’aliénisme puis de la psychiatrie ; ses effets et ses ressorts ont été décrits, interprétés, figurés, par des écrivains, des philosophes et des artistes. Les plus grands auteurs, Dante, Shakespeare et Cervantès en particulier, en ont donné des interprétations dramatisées. Joyce prolonge cette tradition quand il désigne l’hallucination comme le procédé mis en œuvre pour l’épisode de « Circé » dans Ulysses. Je me suis attaché à la période, ouverte par l’ère des « faits » positivistes, où le phénomène, identifié par l’aliénisme et la psychiatrie, est passé dans l’arsenal des poétiques expérimentales et subversives (ou polémiques) de la modernité. Je ne me reporte à des œuvres antérieures que dans la mesure où elles ont été des références insistantes durant cette période : Grünewald vu par Huysmans, Léonard de Vinci pour Ernst et Polke.
En France, l’ère des « faits », correspondant à l’approche positiviste des phénomènes psychiques, fut aussi celle de l’« actualisme » dans la littérature et dans l’art, depuis Géricault et Courbet. Le parti pris des données factuelles de l’expérience se doublait du parti pris des sujets empruntés à l’actualité (contre les fables ou autres représentations du passé). L’auteur de Madame Bovary, prototype du roman actualiste, est aussi l’auteur de La Tentation de saint Antoine, qui applique l’hypothèse hallucinatoire à l’exubérance des croyances religieuses. Mais l’effet d’éclairage est réciproque : le fait hallucinatoire s’inscrit dans l’histoire des croyances autant qu’il en révèle la teneur délirante. L’hallucinatoire est la forme actualiste de la « vision » et de l’extase.
Depuis les premiers temps de l’aliénisme, les artistes qui ont mené, voire revendiqué, une activité visionnaire n’ont cessé de devoir rendre des comptes à la raison médicale. Celle-ci leur fournit aussi des critères pour explorer les frontières du merveilleux et de l’animisme : celles que Freud aborda plus tard en interprétant le sentiment d’Unheimlichkeit (l’« inquiétante étrangeté »). L’étude des mécanismes de l’hallucination se plaçait dans le sillage de la pensée critique des Lumières, elle servit un combat anticlérical. L’activité visionnaire était rattachée aux faits et gestes du sujet empirique, biographique ; le surnaturalisme, avec sa référence insistante à la nature, remplaçait le surnaturel. Les réinventions de l’art visionnaire depuis le dix-neuvième siècle ne sont pas issues, sur un mode sauvage et spontané, d’une « révolte romantique » contre l’empire de la raison positive, ni d’un nouvel attrait pour l’occulte et les miracles de l’esprit. Elles sont passées par le double filtre de la critique et de la clinique. Nerval a imprimé une nouvelle puissance lyrique à l’écriture de soi en répondant de sa folie. Rimbaud préconisait « un long, immense et raisonné [je souligne] dérèglement de tous les sens ». Dans son sillage, les surréalistes ont fait de l’hallucination ordinaire, hypnagogique (entre veille et sommeil), une méthode de « voyance » profane.
Mais l’hallucination procède aussi et d’abord, de manière fondamentale, d’une négation de l’actualité perceptive. C’est pourquoi elle fut, plus que le rêve (ou l’onirisme), le principe d’une protestation contre l’état des choses, contre « le mensonge de l’être » (Artaud). Pour Flaubert, le sentiment de joie qui accompagne l’hallucination artistique tenait à un oubli complet de l’environnement actuel. Il est significatif que la poésie de Rimbaud, comme celle de Mallarmé, ait été rattachée à l’histoire de la pensée mystique. Dans l’accès à l’invisible que constitue l’illumination, ou contemplation du divin, l’image est pure présence de l’absence, sans contenu visuel ; l’imagination participe entièrement, sans reste sensible, à la transcendance qui en est le principe. La négation hallucinatoire rejoint la protestation ascétique contre l’encombrement des images sensibles. Les visions prodigieuses de saint Antoine sont celles d’un ermite, elles procèdent d’une situation de retrait ; elles viennent occuper le vide produit par l’ascèse.
C’est précisément parce qu’elle condense et accomplit le pouvoir de négation psychique de l’actualité perceptive que l’hallucination artistique rejoint la pensée visionnaire. La clarté des esquisses de Turner transpose l’éblouissement spirituel dans le domaine de la vue (veduta) et du champ coloré. L’histoire de l’hallucination artistique, telle que je la retrace, rejoint ici un renouveau de la psychophysiologie et, plus particulièrement, de l’hypnose, appliquée à l’étude de la pensée en images. Je maintiens toutefois la référence au sujet biographique, c’est-à-dire le lien entre les images et les formes verbales : enquête ou récit fictif, auto-observation ou témoignage poétique. Car ce qui s’est produit dans le domaine des arts visuels ne peut être isolé du domaine « littéraire ». Mon enquête sur la pensée en images inclut l’examen des images de la pensée produite dans les textes. À l’encontre du schéma biographique (« la vie et l’œuvre ») hérité de la Renaissance, l’histoire des formes artistiques peut se passer de la psychologie : genre, style, répertoire, ne sont pas des notions psychologiques. Mais, depuis le dix-neuvième siècle, la production de cas cliniques dans les textes psychiatriques a favorisé une approche psychocritique de l’art et de la littérature. On voudrait aujourd’hui l’écarter au profit d’une approche psychophysiologique délivrée du sujet et de l’inconscient freudien. Je préfère considérer que l’apport du freudisme s’inscrit dans une histoire qui ne peut être réécrite sans lui.
Les interrogations sur les pouvoirs de l’image ont toujours fait appel à des théories de la psyché. L’image est double : elle est à la fois production matérielle et réalité mentale. La théorie de l’imagination comme représentation mentale remonte à la notion de phantasia développée par les penseurs de l’Antiquité gréco-latine depuis Aristote. Les sciences modernes du psychisme doivent beaucoup au vocabulaire de la philosophie antique. Une question qui traverse tout le livre, celle des rapports de l’hallucination au fantasme, procède des glissements sémantiques de cette terminologie. La proximité de l’hallucination à ce que Freud désignait par le mot allemand Phantasie (« fantasme » en français) est inscrite dans la théorie des phantasmata (pluriel de phantasma), considérés par les stoïciens comme les productions pathologiques du pouvoir imaginatif (phantastikon). Les « visions » hallucinatoires sont à la « vue » ce que les phantasmata sont à la phantasia, définie comme la capacité de représentation mentale des objets perçus. L’auteur latin Quintilien avait déjà proposé de traduire phantasma par visio. Et si, en français, on nomme « fantasme » la Phantasie freudienne, c’est que les affaires de traduction, comme toujours, touchent à l’instabilité des objets du désir.
De Blake (né en 1757) à Polke (mort en 2010), l’histoire de l’hallucination artistique est indissociable des avatars, ou réinventions, de la « vision » dans une période marquée par la constitution et la transformation des sciences de la psyché. L’adjectif « visionnaire » n’a jamais donné lieu à une définition précise ; les historiens d’art l’ont parfois employé de préférence à « fantastique », pour qualifier notamment des effets d’irréalité ou d’hyperréalité spectrale. J’aurais pu partir de Goya ; cette ouverture mène également à Polke. Mais Blake s’est opposé à la philosophie sensualiste des Lumières, autant qu’aux formes dogmatiques de l’anglicanisme ; cela fit de lui la victime exemplaire du soupçon rationaliste, puis le parangon d’une imagination mythopoétique et protestataire. Fondés sur l’exemple des grandes vaticinations prophétiques, ses livres enluminés inaugurent l’ère d’une poésie concrétisée en images qui, au vingtième siècle, n’a cessé de franchir les frontières institutionnelles séparant arts visuels et expression littéraire (au sens large du terme), œuvre et délire.
Comme Blake, Rimbaud rêvait d’un corps intégral. Les frontières entre les arts sont franchies avec la production d’une image du corps qui répond à l’interaction de « tous les sens » (Rimbaud). L’hallucination, artistique ou pathologique, ne se réduit pas au domaine de la vue ; la teneur hallucinatoire de l’art moderne ne peut être limitée à une esthétique des arts visuels. Le « voyant » n’est pas un visuel. Ses « visions » sont aussi bien des phrases entendues, qui lui ont été dictées. L’activité hallucinatoire mobilise l’ouïe autant que la vue. Les voix entendues font image. Le pathos dramatisé de la jalousie chez Munch et les scénarios de la terreur chez Kafka montrent que le tableau, comme le récit, réduit éventuellement à une phrase, sont des lieux et des formes du délire, où l’hallucination rencontre le fantasme. Pour le sujet, hallucination et fantasme produisent des effets de vérité similaires, qui soutiennent la construction d’un mythe individuel ou d’une réalité seconde. Celle-ci présente parfois la qualité de « belles sensations » (Unica Zürn). En suivant les indications d’André Bazin, on peut également déceler une modalité hallucinatoire du fantasme dans l’exigence de réalisme développée par le cinéma, de Stroheim à Buñuel.
L’histoire des réinventions modernes de l’art visionnaire est généralement réduite à quelques moments ou mouvements, consacrés par des appellations en « -isme » : romantisme, symbolisme, expressionnisme, surréalisme… À défaut de pouvoir écarter radicalement ces catégories historiographiques, j’ai essayé de mettre en lumière des continuités moins repérées, des récurrences. L’histoire de la gravure, par exemple, de Blake et Goya jusqu’à Bruce Conner, en passant par Odilon Redon, Rodolphe Bresdin, Charles Meryon ou Max Klinger, montre comment l’art d’imagination a pris, ou retrouvé, la voie du fantastique. Celui-ci n’était plus l’expression d’un démonisme combattu et stimulé par la morale chrétienne, comme il le fut au seizième siècle (le siècle de la gravure) ; il était devenu le genre de l’hallucination. En même temps, l’imagerie des tentations, en particulier celle de saint Antoine, fut constamment réinterprétée, actualisée ; Artaud s’y réfère quand il prône un théâtre de l’hallucination. Dans l’histoire de l’art moderne, les emprunts, les reprises et citations s’apparentent aux effets du collage, devenu lui-même chez Max Ernst un procédé hallucinatoire.
J’aborde finalement un phénomène culturel, le psychédélisme, parfois considéré comme un accomplissement de l’hallucination artistique. J’examine sa place dans une contre-culture des années 1960, qui a souvent confondu l’ascèse visionnaire avec le postulat d’une activité artistique aniconique, fondée sur le refus ou l’occultation de l’objet. Le slogan de « l’imagination au pouvoir » lancé dans les rues en mai 1968 retrouvait, sur un mode libertaire, la protestation surréaliste contre le principe de réalité édifiée en ordre moral. Allen Ginsberg et Aldous Huxley avaient transmis l’exemple de Blake. Le psychédélisme se voulut, selon l’un de ses premiers historiens, « le surréalisme de l’ère technologique » ; il fut aussi une nouvelle manifestation, élargie, d’un « dilettantisme religieux » récurrent depuis la fin du dix-neuvième siècle.
Le phénomène perdure. Mais j’observe surtout son chevauchement avec un mouvement artistique antérieur, l’Informel, né de la guerre, qui s’était déjà voulu l’expression (ou l’enregistrement) d’un état critique des formes léguées par l’histoire de l’art moderne. Tandis que le psychédélisme favorisait la teneur psychophysiologique de l’image, l’Informel opposait les aléas de la matière et du geste à l’idée de la forme construite. Mon propos se resserre sur des artistes, Bruce Conner et Sigmar Polke, dont les œuvres ouvertes, polymorphes, mêlent les deux orientations, en mobilisant des références historiques précises, choisies, parfois lointaines. L’hallucination artistique ressortit à une disposition et un travail psychiques qui peuvent mener à l’extase ; elle permet aussi de produire une actualité autre, dans des images, des textes, des choses matérielles, concrètes.
(Tous droits réservés)

